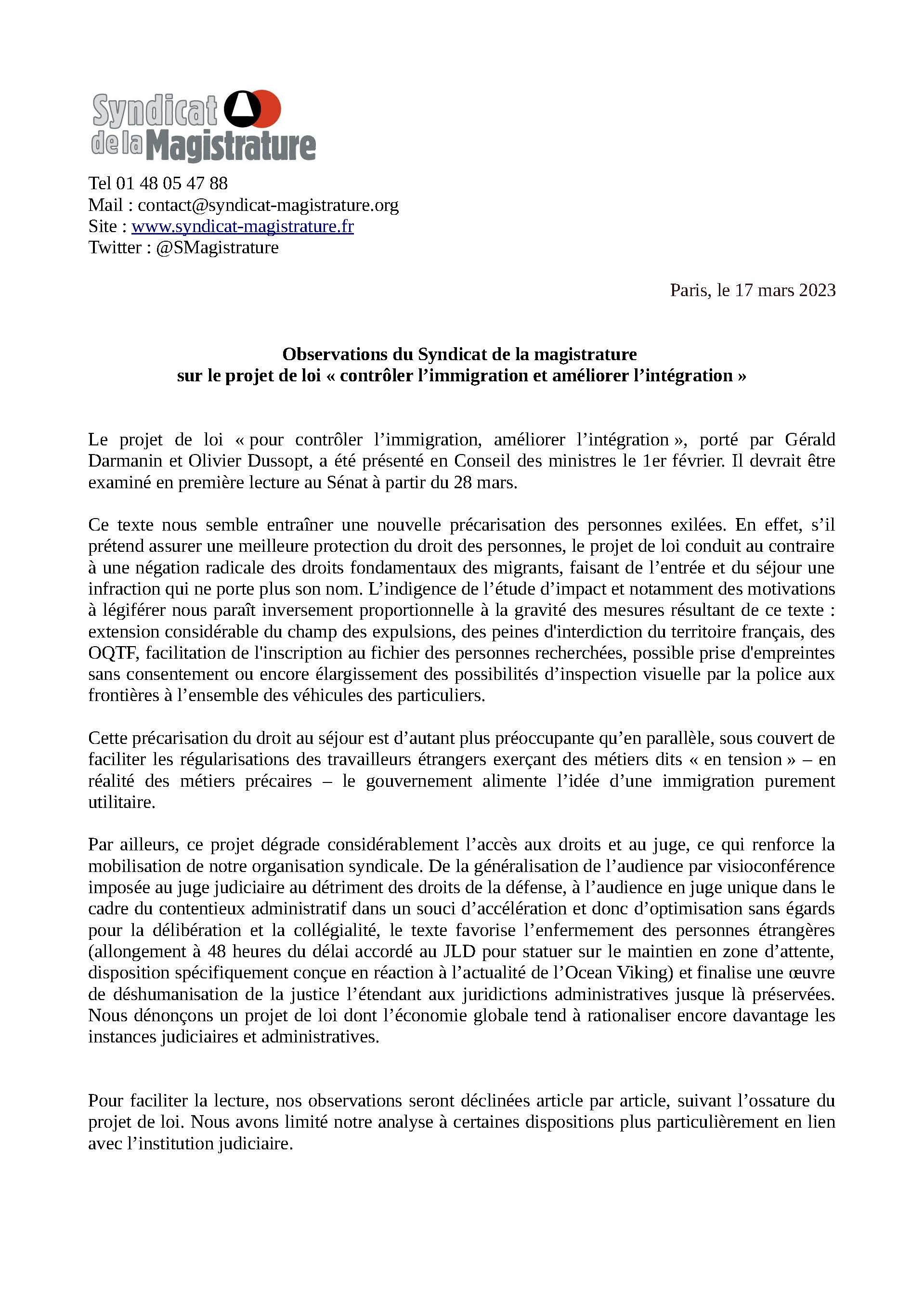Alors que le gouvernement soumet au Sénat son projet de loi sur l’asile et l’immigration, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de Luxembourg vient de rendre un arrêt, en réponse à une question préjudicielle du Conseil d’Etat, qui oblige la France à mettre ses pratiques aux frontières et notamment à la frontière franco-italienne en conformité avec le droit de l’Union européenne.
Depuis 2015, la France a rétabli les contrôles à ses frontières intérieures, par dérogation au principe de libre circulation dans l’espace Schengen. Et depuis cette date, elle enferme dans des bâtiments de fortune et refoule des personnes étrangères à qui elle refuse l’entrée sur le territoire, notamment à la frontière franco-italienne, comme c’est le cas, en ce moment même, à Menton ou à Montgenèvre. En prévision de l’augmentation des arrivées en provenance d’Italie à la mi-septembre, les dispositifs de surveillance ont été renforcés et les baraquements dits de « mise à l’abri » se sont multipliés. Pour enfermer et expulser en toute illégalité, car les constats sur le terrain démontrent que ces contrôles débouchent sur de l’enfermement et des refoulements de personnes en dehors d’un cadre juridique défini.
À de multiples reprises, depuis plusieurs années, nos associations ont protesté contre cette situation et ont saisi, en vain, les tribunaux français pour obtenir qu’il soit mis fin à ces pratiques en conséquence desquelles, au fil des années, des milliers de personnes ont été privées de liberté et expulsées, sans pouvoir accéder à leurs droits fondamentaux (accès à une procédure, accès au droit d’asile, recours effectif).
Nos associations ayant contesté la conformité au droit européen de la disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) qui permet à l’administration de prononcer des « refus d’entrée » aux frontières intérieures sans respecter les normes prévues par la directive européenne 2008/115/CE, dite directive « Retour », le Conseil d’État a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle sur ce point.
Dans sa décision du 21 septembre 2023, la CJUE a répondu à cette question en retenant le raisonnement juridique défendu par nos organisations. Elle estime que lorsqu’un État membre a réintroduit des contrôles à ses frontières intérieures, les « normes et procédures prévues par cette directive » sont applicables aux personnes qui, se présentant à un point de passage frontalier situé sur son territoire, se voient opposer un refus d’entrer.
Par cette décision, la CJUE rappelle à tous les Etats membres de l’UE leurs obligations lorsqu’ils rétablissent des contrôles à leurs frontières intérieures :
- notifier à la personne à qui elle refuse l’entrée une décision de retour vers un pays tiers ainsi qu’une voie de recours effective (autrement dit on ne peut pas se contenter de refouler en la remettant aux autorités de l’État membre de provenance) ;
- lui accorder un délai de départ volontaire (vers le pays tiers désigné dans la notification) ;
- n’imposer une privation de liberté à cette personne, dans l’attente de son éloignement, que dans les cas et conditions de la rétention prévus par la directive « Retour ».
Depuis fin septembre, nos associations organisent de manière régulière des observations des pratiques des forces de l’ordre à la gare de Menton Garavan et aux postes de la police aux frontières de Montgenèvre (Hautes-Alpes) et de Menton pont Saint-Louis (Alpes-Maritimes). Force est de constater que les pratiques à la frontière intérieure n’ont pas évolué. Les contrôles au faciès aux points de passage autorisés (PPA), ainsi que dans d’autres zones frontalières, sont quotidiens, les procédures de « refus d’entrée » sont toujours réalisées à la va-vite, sur le quai de la gare, devant le poste de police ou parfois à l’intérieur de celui-ci, sans interprète et sans examen individuel de la situation des personnes. Des majeurs comme des mineurs sont refoulés, des personnes à qui l’entrée sur le territoire est refusée sont privées de liberté, sans pouvoir demander l’asile ou contester la mesure d’enfermement à laquelle elles sont soumises, et sans accès à un avocat à ou une association.
Interrogée par des élus qui, pour certains, se sont vu opposer des refus d’accès au locaux dits « de mise à l’abri », la police aux frontières a précisé qu’aucune directive ne lui avait été transmise depuis la décision de la CJUE.
Parce que la France persiste dans son refus de se conformer au droit de l’UE, les pratiques illégales perdurent et des dizaines de personnes continuent, quotidiennement, à être victimes de la violation de leurs droits fondamentaux.
Il revient désormais au Conseil d’État de tirer les enseignements de la décision de la CJUE et de mettre fin aux pratiques d’enfermement et de refoulement aux frontières, hors du cadre juridique approprié, notamment à la frontière franco-italienne.
Organisations signataires :
ADDE
Anafé (Association nationale d’assistance pour les personnes étrangères)
Emmaüs Roya
Gisti
Groupe accueil solidarité
La Cimade
Ligue des droits de l’Homme
Roya Citoyenne
Syndicat de la Magistrature
Syndicat des avocats de France
Tous migrants