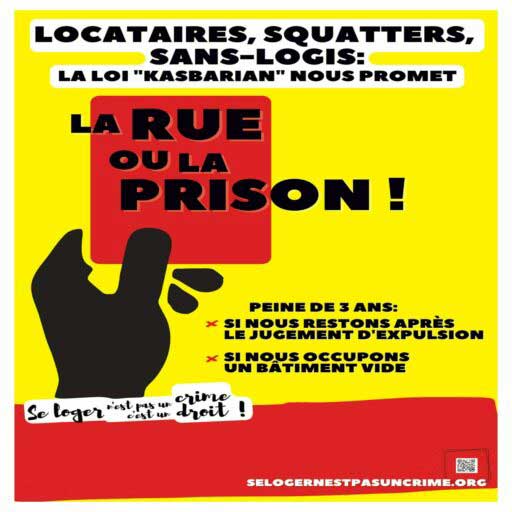Le projet de décret portant simplification de la procédure d’appel en matière civile est en cours d’examen au Conseil d’État.
Une réforme tant attendue
La réforme dite « Magendie » ainsi que la réforme de 2017 ayant notamment introduit les délais du circuit court, ont entrainé une « surcharge procédurale ». Les textes souvent dépourvus de clarté, parfois contradictoires, pensés dans une logique de gestion de flux, se sont en effet multipliés. A cela s’est ajoutée une surenchère de la part de juridictions d’appel asphyxiées, tentées de penser la sanction procédurale comme un filtrage qui ne dit pas son nom.
La nécessité d’une réforme de la procédure d’appel fait donc l’objet d’un large consensus des praticiens et des universitaires. Elle a été encouragée par la jurisprudence de la CEDH avec l’arrêt Lucas c. France du 9 juin 2022, ce dont la Cour de cassation a manifestement pris acte dans sa jurisprudence récente, revenant sur un formalisme processuel excessif.
Si le garde des Sceaux s’était engagé, à « desserrer les délais », le comité des états généraux de la justice avait, de manière plus ambitieuse, préconisé une réforme profonde visant à l’allègement du formalisme de la procédure d’appel.
Une concertation à géométrie variable
La version finale du projet de texte n’aura été soumise aux organisations syndicales qu’une semaine avant le comité social d’administration des services judiciaires (CSA-SJ) du 22 novembre où elles devaient se prononcer pour avis. Cette version était pourtant profondément différente de la version initiale qui nous avait été soumise, sans pour autant remédier aux difficultés soulevées. En à peine quelques jours, les syndicats devaient donc pouvoir consulter leurs adhérents et définir une position sur une réforme technique majeure, touchant aux principes fondamentaux du procès civil et qui aura des conséquence d’importance sur l’accès au juge d’appel.
Lors du CSA-SJ du 22 novembre 2023, nous avons appris que nos principales propositions avaient été rejetées, la DACS nous ayant indiqué que contrairement à notre demande, « la philosophie Magendie a été maintenue car cela faisait consensus au sein du groupe de travail notamment composé de la Conférence nationale des premiers présidents et du Conseil national des barreaux ». Elle a précisé qu’elle comprenait et respectait qu’il puisse y avoir une autre philosophie de l’appel, celle que nous défendions, mais qu’elle avait été clairement écartée par le groupe de travail.
Alors qu’était venu le temps de promouvoir, en droit interne, la fin d’un formalisme processuel excessif de l’appel en matière civile, les autres organisations syndicales ont préféré, à l’exception notable de la CGT, valider sans aucune réserve, un projet de décret plus que décevant, aujourd’hui examiné par le Conseil d’État.
Une vision étriquée de la procédure civile
Comme nous l’avions déjà dénoncé dans nos observations relatives à la précédente mouture du projet, si certaines propositions vont dans le sens d’une clarification, la logique de gestion des flux reste au coeur ce décret qui maintient, par ailleurs, des interprétations de textes et des constructions jurisprudentielles allant à l’encontre des attentes des praticiens mais également des justiciables.
Ainsi, ce décret prévoit notamment la procédure sans audience devant la cour d’appel, introduit une mise en état qui ne dit pas son nom dans la procédure à bref délai au risque d’asphyxier définitivement la justice d’appel, élargit les compétences du conseiller de la mise en état dans le circuit ordinaire, venant entraver l’accès au juge d’appel et confirme un circuit court enserré dans des délais procéduraux qui n’ont aucun sens au regard des délais d’audiencement des cours d’appel.
Par ailleurs, cette dernière mouture abandonne – étonnamment – l’augmentation des délais pour la procédure ordinaire alors qu’il s’agissait de l’une des mesures phare de cette réforme. Cet allongement des délais, annoncé par le garde des sceaux, répondait à une forte demande des praticiens. Cet abandon, répondant à un prétendu consensus du groupe de travail pourtantcontraire à la demande des praticiens, ne peut qu’interroger alors même que les statistiques du ministère de la Justice de 2019 démontrent l’absence d’impact positif des délais imposés par les décrets « Magendie » sur la durée de traitement des appels et que les dossiers dont l’instruction ou la mise en état est clôturée attendent des mois, voire des années, leur audiencement, en raison des difficultés récurrentes en ressources humaines et matérielles des juridictions d’appel.
Enfin, ce projet de texte prévoit un changement total de numérotation des textes régissant la procédure à bref délai et de la procédure ordinaire. Ce changement sera source de complexification pour les praticiens dans la différenciation des deux procédures, alors même que l’assimilation de textes sans cesse modifiés, renumérotés, rarement à droit constant, n’en est, à l’évidence, pas favorisée.
Dès lors, ce projet de réforme laisse un goût amer. La Chancellerie disposait en effet d’une opportunité de mettre en placeune procédure civile proportionnée et adaptée au but poursuivi : faciliter l’accès au juge d’appel dans le respect d’un procès équitable. Elle a manifestement échoué.
Réforme_de_la_procédure_d'appel_observations_SM (619 KB)
Réforme_de_la_procédure_d'appel_propositions_SM (320 KB)