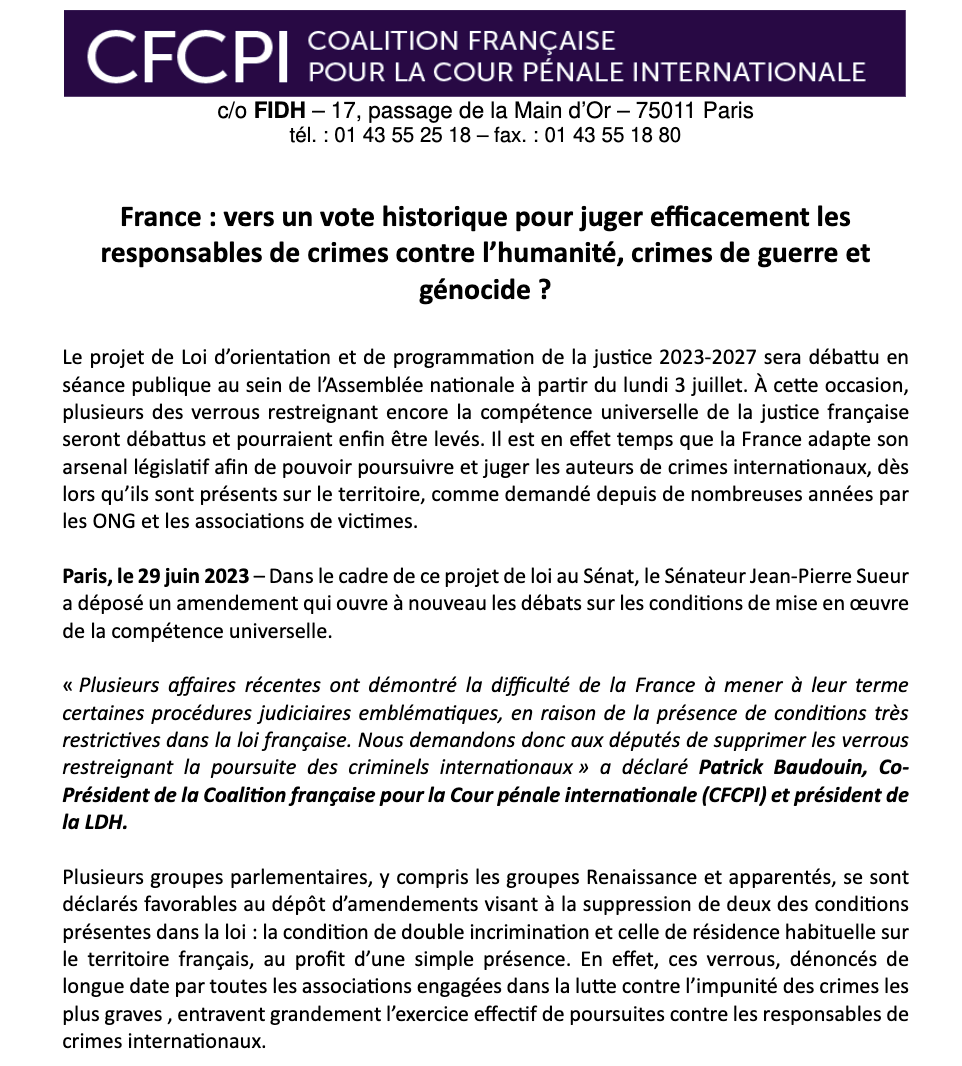Colloque MEDEL - 31 mai 2024
Le rôle des magistrats dans la construction démocratique - une perspective européenne
Inscriptions par mail jusqu'au 28 mai à l'adresse : inscriptions@medelnet.eu
Présentation du colloque :
Quelle place occupent aujourd’hui les magistrats dans l’édification et la pérennité des régimes démocratiques ?
Dans un contexte national où la culture politique demeure marquée par le bonapartisme et l’hégémonie du pouvoir exécutif, la question pourra paraître incongrue à certains. Dans une perspective européenne, elle apparaît pourtant aussi évidente que fondamentale. Depuis la libération, les tribunaux y sont en effet considérés comme l’un des piliers de l’ordre juridique humaniste mis en place sur le continent en réaction aux violations massives de droits humains commises durant la seconde guerre mondiale. Un ordre juridique qui, comme le rappelle le préambule du statut fondateur du Conseil de l’Europe du 5 mai 1949, promeut l’idée que « toute démocratie véritable » se fonde non seulement sur les « principes de liberté individuelle, de liberté politique », mais également sur celui de « prééminence du droit » et, notamment, des libertés garanties par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Une conception faisant écho à celle portée au sein d’une Union européenne très officiellement « fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme » (Article 2 du Traité sur l’Union européenne).
Or, pour assurer une telle prééminence, les juges et procureurs se retrouvent nécessairement en première ligne. A l’approche des élections au Parlement européen, il nous apparaît ainsi utile de mettre à nouveau en lumière les fondements, les modalités et les limites du rôle des magistrats dans la préservation de l’Etat de droit démocratique. Car ce dernier reste plus que jamais, sinon à sauvegarder, du moins à consolider. Et, comme le montrent notamment les exemples de la Pologne et de la Hongrie, les magistrats qui entendent garantir à leurs concitoyens le règne de la loi (pour reprendre l’expression anglo-saxonne) se doivent parfois de mener un véritable combat institutionnel qui les exposent personnellement. Dans ce combat, les liens qu’ils peuvent nouer directement avec d’autres acteurs de la société civile s’avèrent bien souvent déterminant de leurs succès et, plus largement, de la vitalité démocratique du débat public. Mais un tel engagement suscite en retour des questionnements légitimes sur son articulation avec les devoirs d’indépendance et d’impartialité que les juges et procureurs se doivent par ailleurs d’observer. A cet égard, la Cour européenne des droits de l’homme nous rappelle que « la liberté d’expression des juges s’agissant des question concernant le fonctionnement du système judiciaire peut se transformer en devoir de s’exprimer publiquement pour la défense de l’Etat de droit et de l’indépendance de la Justice quand ces valeurs fondamentales sont menacées » (Cour EDH, ŻUREK v. POLAND, n°39650/18, 16 juin 2022, n°222). Comment mettre en pratique ces principes ? Comment faire vivre le dialogue entre les citoyens et leurs juges au bénéfice de la démocratie ? Telles sont les autres questions que, parmi d’autres, l’association Magistrats européens pour la Démocratie et les libertés (MEDEL) et le syndicat de la magistrature proposent de soumettre au débat à l’occasion du présent colloque.
Programme
10 h : Accueil par le président du tribunal judiciaire de Paris
10h15 : Ouverture du colloque par la présidente du Syndicat de la Magistrature
10h30 : les magistrats garants de l’Etat de droit démocratique, sous la présidence de Simone Gaboriau, magistrate honoraire
- Introduction historique : la place du juge dans la construction de l’ordre juridique européen à la Libération - Mathieu Touzeil-Divina, professeur de droit public et Sophie Prosper, docteur en droit privé
- "Défendre l'indépendance de la justice par le contentieux. Comment éviter que l'État de droit ne se politise ?" - Carsten Zatschler SC Senior Counsel
- La mobilisation du droit européen dans la protection des libertés des citoyens : une arme à double tranchant
- L’exemple du droit de la consommation - Simon Chardenoux, Juge
- La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et les droits économiques et sociaux - Ismaël Omarjee, professeur à l’Université Paris Nanterre
Questions
Pause méridienne
14h30 : les magistrats, acteurs du débat démocratique, sous la présidence de Lara Danguy des Déserts, coordonnatrice de la rédaction de la revue Délibérée
- Les moyens du dialogue avec la société : les garanties européennes de la liberté d’expression des magistrats - Isabelle Boucobza, professeure à l’Université paris Nanterre ;
- Le dialogue entre juges et citoyens en Pologne - Dorota Zabludowska, juge, et Paulina Kieszkowska, membre de l’ONG « the free courts initiative »,
- Le dialogue en Italie dans le contexte de la lutte contre la mafia - Fabrizio Vanorio, procureur antimafia à Naples ;
Questions
16h30 : Intervention de clôture : Mariarosaria Guglielmi, présidente de MEDEL