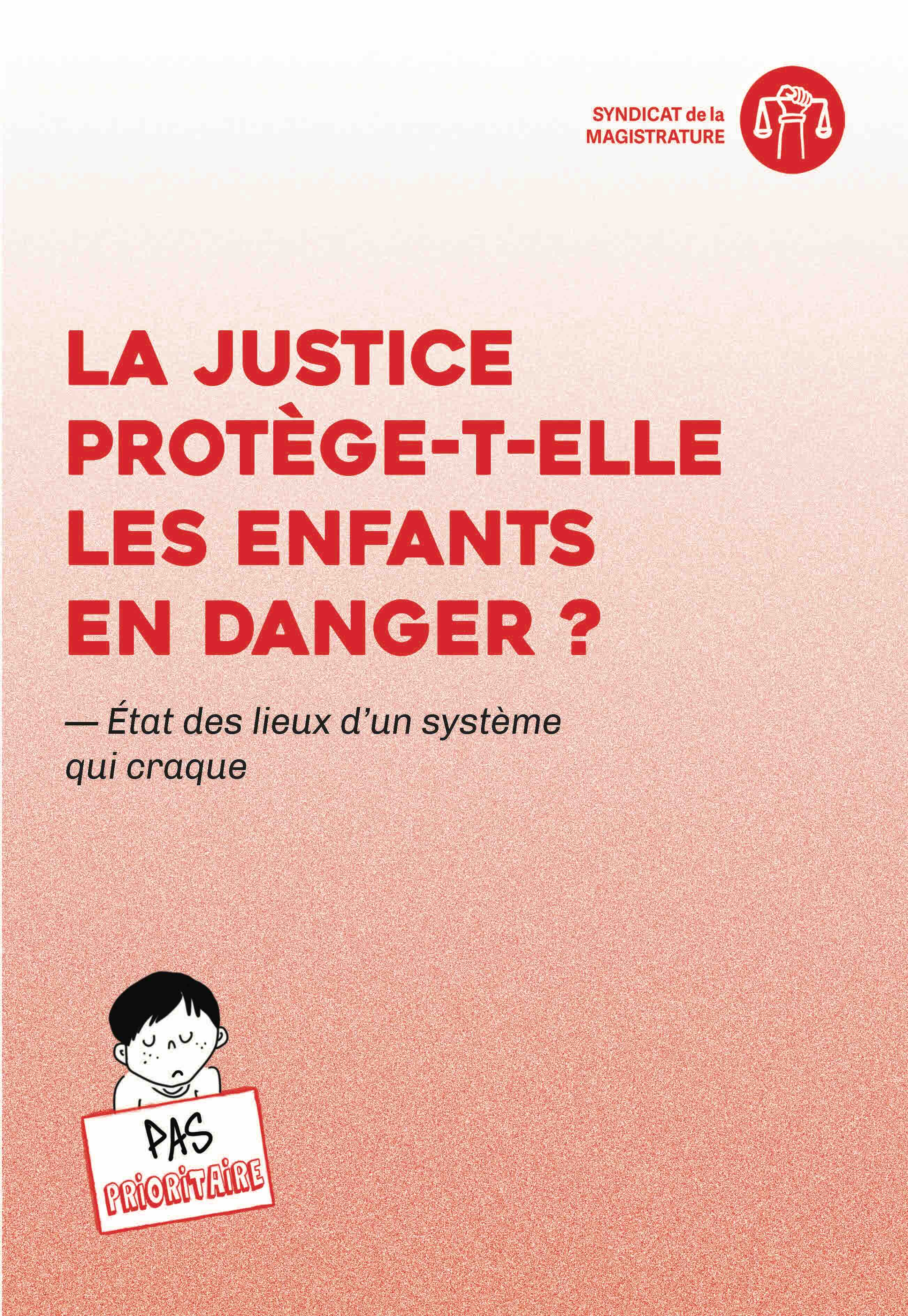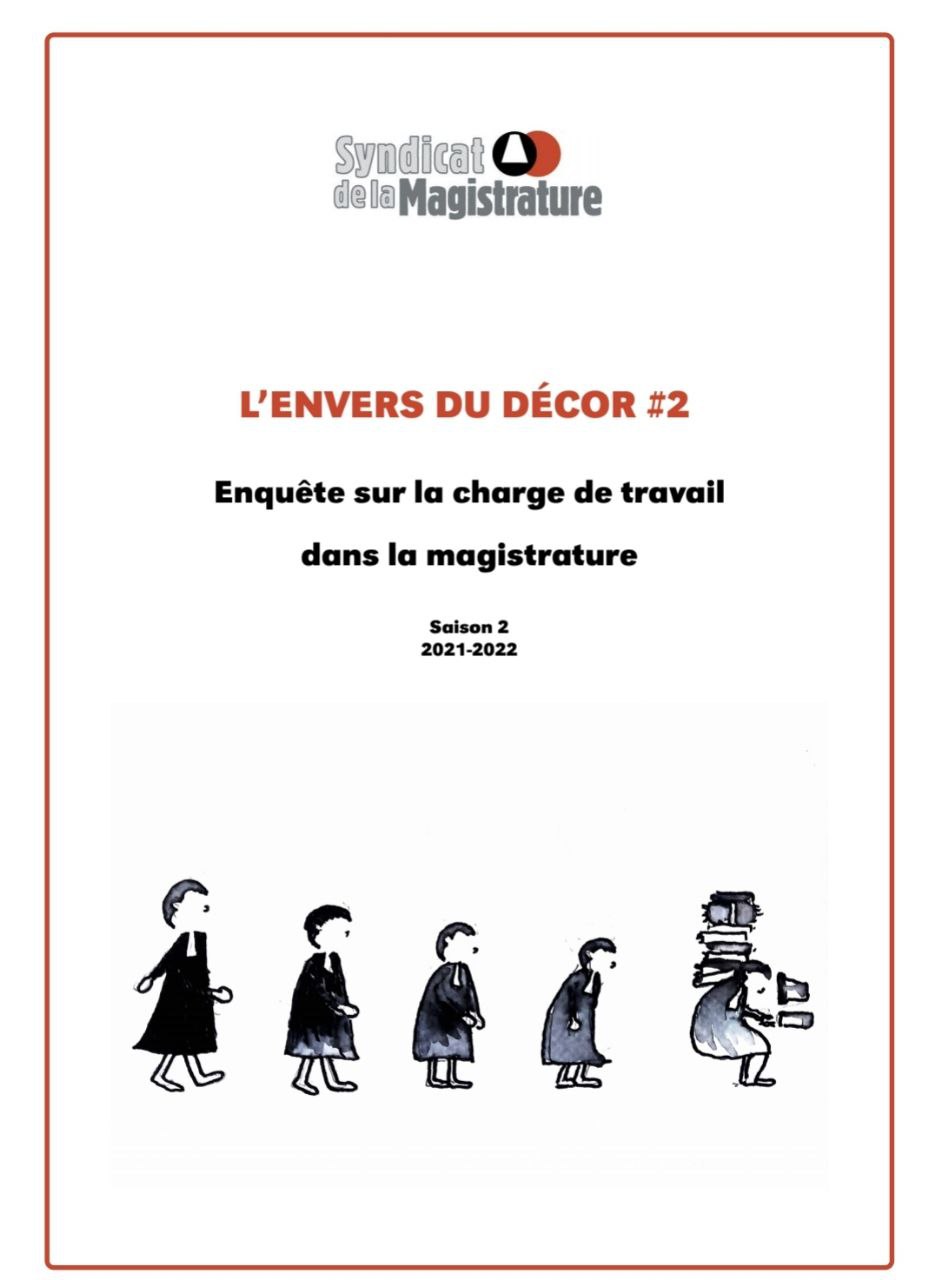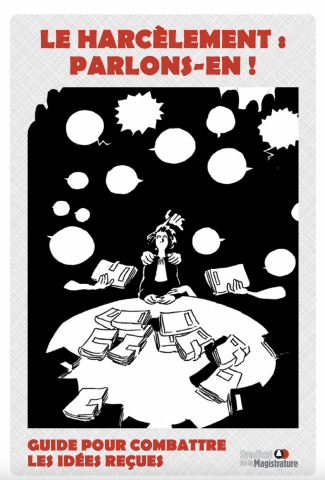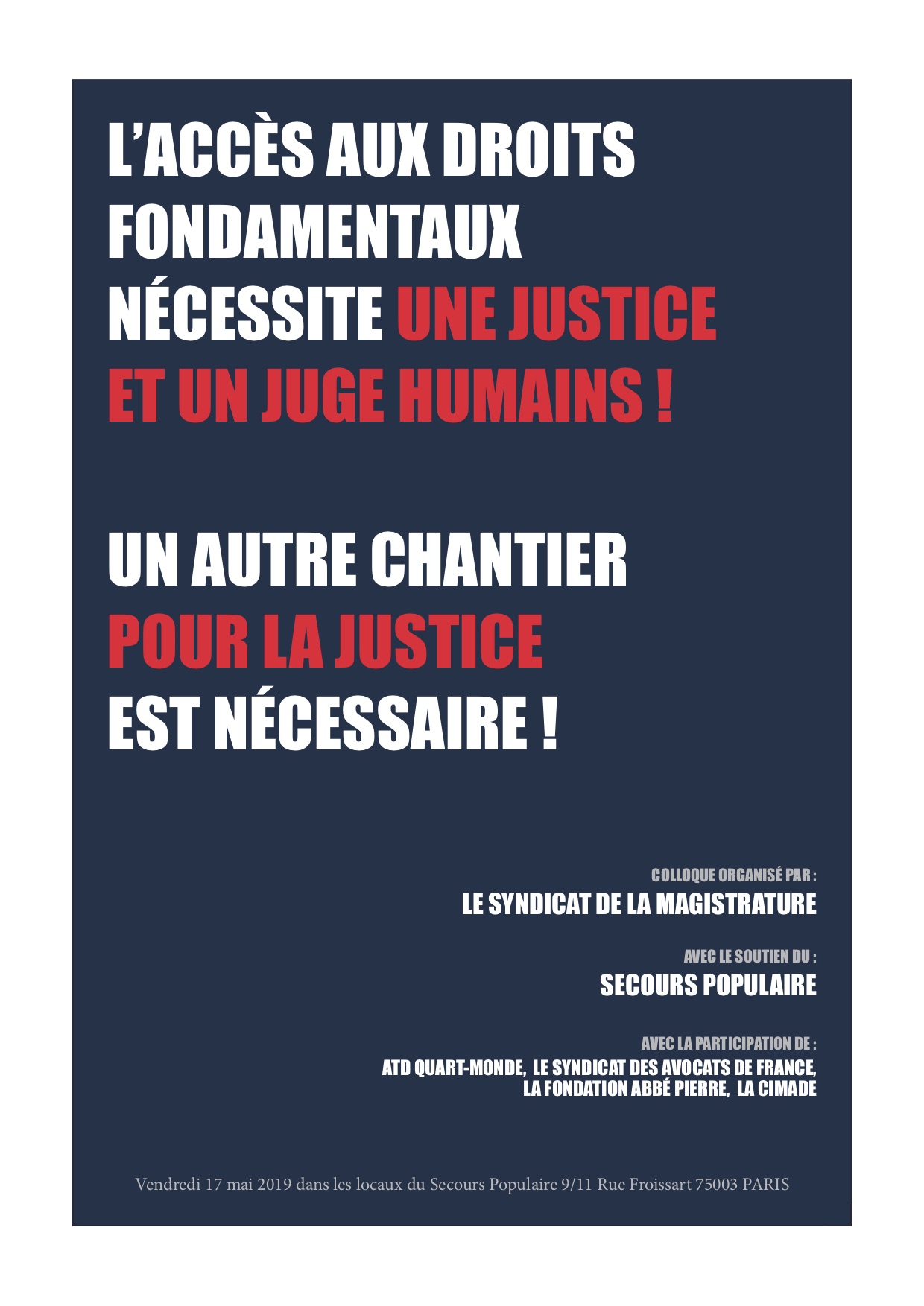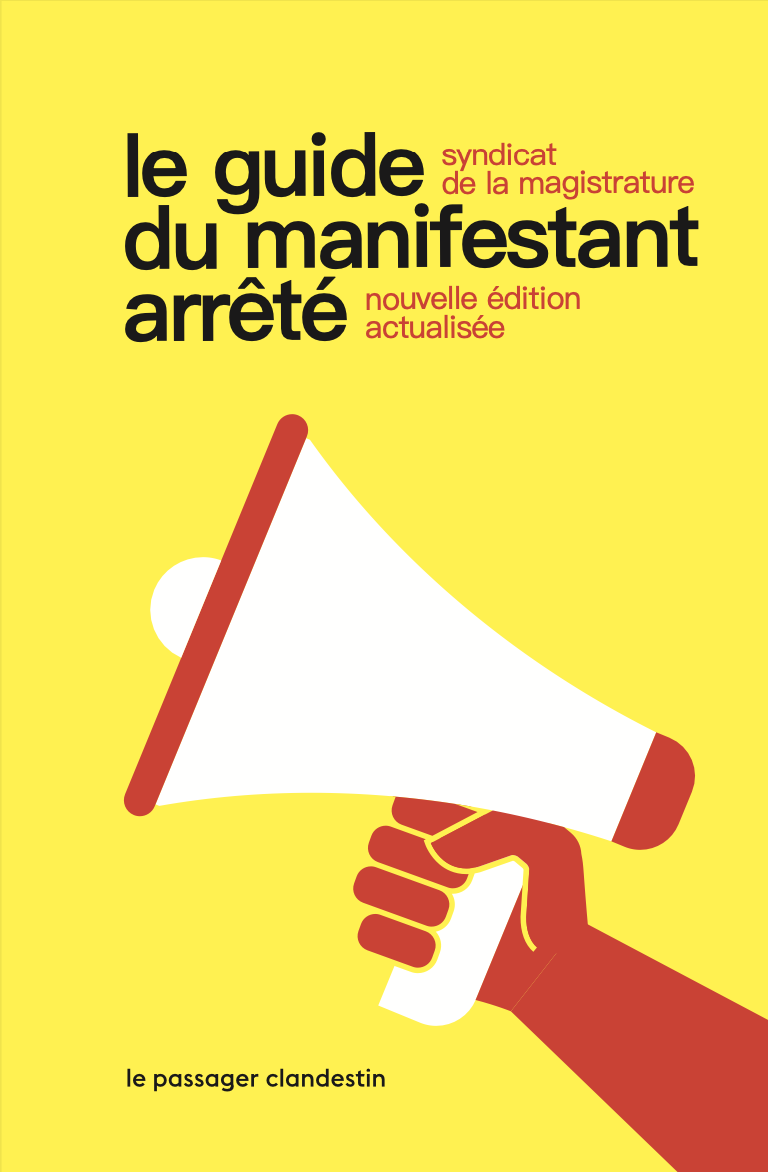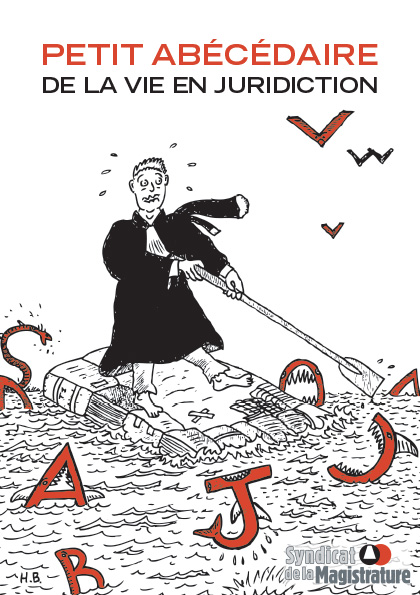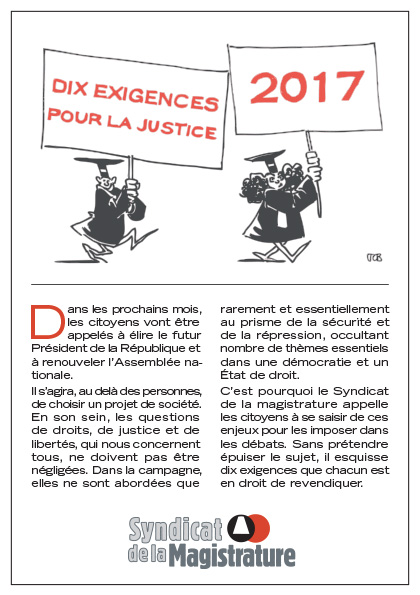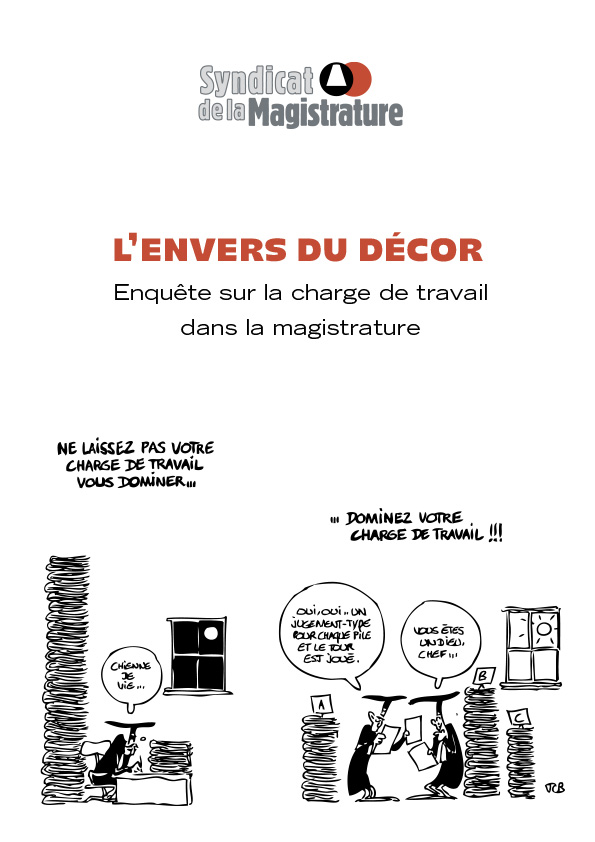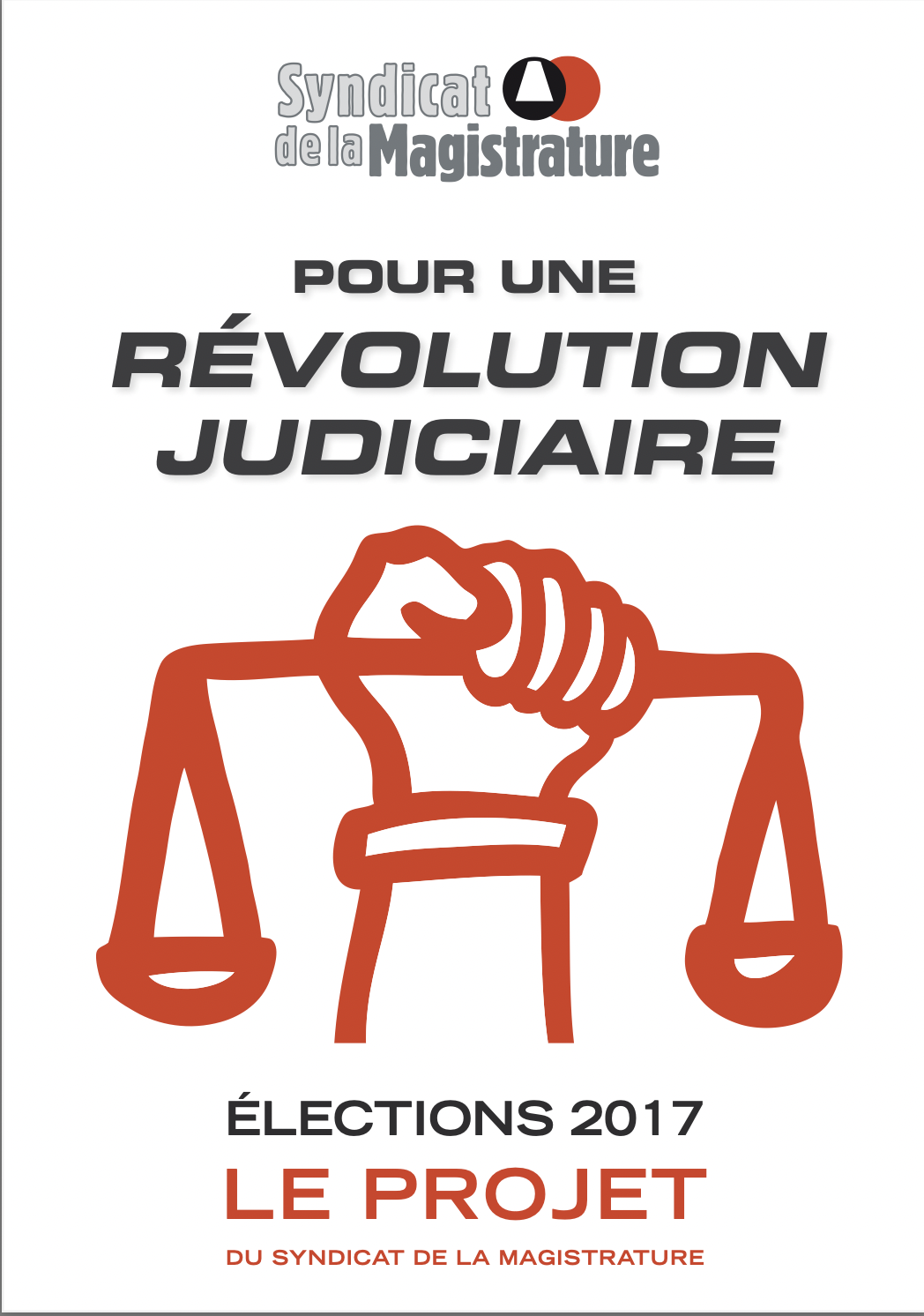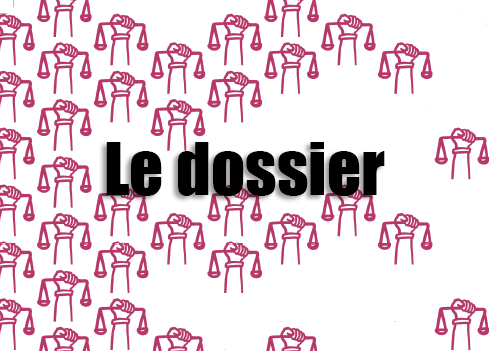
DOSSIER
Etats généraux de la Justice
Opération de communication, travaux biaisés, vernis démocratique : nos analyses de la méthodologie de ces états généraux et nos actions sont réunies dans cette rubrique. Tous les articles…
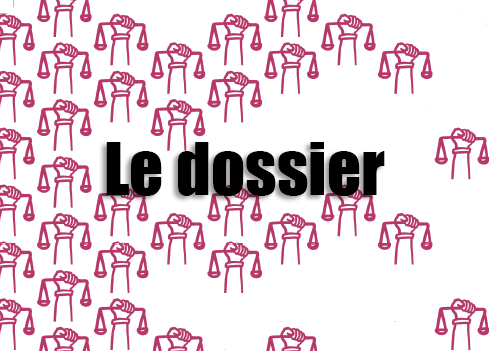
DOSSIER
Mobilisation pour des moyens dignes pour la Justice !
A la suite de la tribune publiée dans le journal Le Monde signée par plus de 7000 professionnels dont plus de 5500 magistrats et 1500 fonctionnaires de greffe, les assemblées générales des juridictions dont celle de la Cour de cassation ont adopté en masse des motions réclamant des moyens dignes pour la justice, les conférences des chefs de juridiction ont apporté leur soutien à cette expression, le CSM a publié un communiqué de presse, les organisations syndicales et professionnelles d'avocats se sont joints à cette mobilisation, ces derniers ayant également publié une tribune. Cette rubrique comporte nos actions dans le cadre de cette mobilisation générale des professionnels de justice. Tous les articles…
Nos guides et livrets
Nos publications sur les réseaux sociaux
Nous suivre sur X/TwitterNous suivre sur Mastodon
Nous suivre sur Instagram